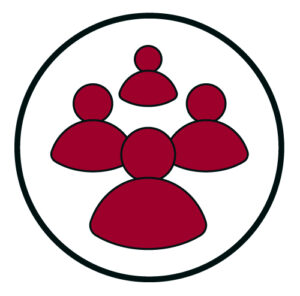La scène face aux questions coloniales
Le débat antiraciste et postcolonial a pris, cette dernière décennie, en France et partout dans le monde occidental, un grand essor. Comme la plupart des milieux, artistiques ou non, le spectacle vivant se targue en général de ne recruter et de ne juger les artistes, les administratifs et les techniciens qu’au mérite et au talent, laissant de côté une discrimination structurelle. Professeure d’Études théâtrales à l’Université Sorbonne Nouvelle, Sylvie Chalaye nous éclaire sur l’histoire de la représentation des non-blancs sur nos scènes, et sur les logiques qui sous-tendent un débat parfois houleux.

Carte noire nommée désir – Photo © Christophe Raynaud de Lage
Vous avez écrit un ouvrage intitulé Race et théâtre : Un impensé politique (Actes Sud, 2020). Le mot “race” a, ces dernières années, été repris par les militants antiracistes alors qu’il s’agit, au départ, d’un terme profondément raciste, renvoyant à une hiérarchie biologique des êtres humains dont nous savons aujourd’hui qu’elle n’a jamais existé. À quoi correspond ce déplacement contre-intuitif ? Et pourquoi appliquer ce mot au monde théâtral ?
Sylvie Chalaye : Certes, la race n’existe pas, c’est une invention. Les scientifiques, anthropologues et historiens admettent aujourd’hui que la théorie des races est une fabrication idéologique et politique qui a permis aux empires coloniaux de justifier leur ascendant sur les peuples dominés, exploités, esclavagisés, mais aussi d’affirmer la nécessité d’exporter et d’imposer, au nom de ce que nous avons appelé LA civilisation, la vision occidentale du monde et l’ordre des races définies comme supérieures. Or, si la théorie des races a été anéantie, l’idée de race et son cortège de préjugés n’ont pas quitté les imaginaires. Enfermer l’autre dans sa couleur de peau et l’assigner à une identité et une origine que nous avons fantasmées pour lui, juste en raison de son “apparaître”, est précisément un geste de racisation. Or, les arts de représentation, tout particulièrement le théâtre et les arts du spectacle, ont largement participé à imprimer dans les imaginaires cette racisation de l’apparaître.
Historienne du théâtre, vous avez étudié l’évolution de la présence afrodescendante sur les scènes françaises et européennes. Nous pensons à de grands rôles (Othello), de grandes figures (Joséphine Baker), de grands auteurs (Aimé Césaire, Dieudonné Niangouna), de grands acteurs (Adama Diop). Existe-t-il des chiffres sur la présence des artistes non-blancs sur nos scènes ? Quel est l’état de la situation aujourd’hui en France ?
S. C. : La présence d’artistes non-blancs dans le paysage théâtral n’est pas une question quantifiable. Il n’est pas possible, et même pas souhaitable, d’avoir des chiffres sur cette présence. L’enjeu n’est pas le nombre de non-blancs dans un casting mais la capacité à penser des distributions qui intègrent, sans les stigmatiser, les apparaître divers des comédien.ne.s. Un artiste non-blanc doit pouvoir jouer d’autres rôles que celui de l’Autre ou de l’étranger. L’apparaître racisé d’un.e comédien.ne ne doit pas être envisagé comme un emploi. Les artistes afrodescendant.e.s sont nombreux.ses et ont grandement participé à l’histoire des arts du spectacle en France et en Europe. Mais un phénomène d’invisibilisation, lié d’abord à la décolonisation et au désir de tourner la page du temps de l’empire colonial, est à l’origine d’une perte de mémoire incroyable. Nous avons ainsi oublié Habib Benglia, Aïcha Goblet, Daniel Sorano, Douta Seck, Georges Aminel, Bachir Touré, Darling Légitimus, et bien d’autres artistes afrodescendant.e.s originaires des Caraïbes ou d’Afrique. L’historiographie théâtrale a complétement oblitéré l’engagement d’un metteur en scène comme Jean-Marie Serreau, qui travaillait dès les années 50’-60’ avec des comédien.ne.s d’Afrique et d’Outre-mer, qu’il distribuait dans toutes sortes de rôles, dans des pièces de Brecht, Genet, Claudel ou Ionesco. Il montait aussi des textes d’auteur.rice.s noir.e.s : Césaire, bien sûr, avec La Tragédie du roi Christophe, mais aussi le Haïtien René Depestre avec Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien, ou l’Ivoirien Bernard Dadié avec Béatrice du Congo au Festival d’Avignon, l’Africaine-Américaine Adrienne Kennedy avec Drôle de baraque à l’Odéon. Serreau meurt en 1973 et son action ne sera pas poursuivie. La crise pétrolière, le chômage, l’immigration et la montée des nationalismes ont conduit à un repli. Les artistes noir.e.s ont commencé à ne plus jouer que des rôles de noirs, d’étrangers, d’immigrés. Ce sera tout le paradoxe des années 80’-90’, pourtant très engagées contre le racisme. La France se passionne pour les “musiques noires”, mais les acteur.rice.s qui marquent cette période – Greg Germain, Med Hondo, Maka Kotto, Isaach de Bankolé, Alex Descas, Félicité Wouassi, Pascal Nzonzi, Lisette Malidor, Bakary Sangaré, Sotigui Kouyaté, Lydia Ewandé, Firmine Richard, pour n’en citer que quelques-un.e.s – se retrouvent à jouer l’idée que l’on se fait du noir : dealer, souteneur ou flic, prostituée ou nounou, sorcière ou femme de ménage.

Carte noire nommée désir – Photo © Vincent Zobler
En mars 2019, des militant.e.s antiracistes ont manifesté contre Les Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne car le metteur en scène Philippe Brunet avait intégré un maquillage rappelant la pratique du blackface. En quoi consiste exactement le blackface, et pourquoi cristallise-t-il autant le débat postcolonial ?
S. C. : Afin de marquer l’origine africaine des Suppliantes, Philippe Brunet avait noirci les visages et les mains des comédiennes, qui portaient également des perruques laineuses. C’est ce grimage qui a été dénoncé comme blackface. Associer l’origine à la couleur de peau et à la frisure des cheveux est une stigmatisation caricaturale et racialiste. Des associations antiracistes ont en effet manifesté et empêché l’accès à une représentation. Il ne s’agissait pas de censure ni d’interdit, mais simplement de faire comprendre en quoi enfermer un.e Africain.e dans un travestissement est problématique. C’est pourquoi Philippe Brunet a finalement eu recours à des masques, ce qui est très différent. Au XIXe siècle aux États-Unis, le blackface était une forme de spectacle clownesque et raciste pris en charge par des comédien.ne.s blanc.he.s qui se maquillaient le visage en noir pour jouer les esclaves des plantations et stigmatiser tous les défauts attribués aux noirs : paresse, concupiscence, ivrognerie, accent et langage argotique, gestuelle dansante, … Thomas Rice a inventé le personnage de Jim Crow en s’inspirant de la chanson d’un vieil esclave claudiquant, et son spectacle l’a rendu célèbre à New York. Ce geste marque le dénigrement raciste mais aussi la réappropriation artistique, car les artistes en blackface qui faisaient le show imitaient les danses noires acrobatiques d’où naîtrait le jazz. Cependant, il ne faut pas croire que la pratique du blackface est seulement américaine et dédouaner l’histoire du théâtre français. En fait, l’invention du “petit nègre” joyeux, dansant, paresseux et libidineux, joué par un.e comédien.ne barbouillé.e, remonte à des spectacles de vaudeville de la fin du XVIIIe siècle. La Négresse ou le pouvoir de la reconnaissance, qui met en scène un valet qui se barbouille le visage pour se faire passer pour un noir, dont il imite également la dégaine et la gestuelle dansante, est une pièce célèbre de Radet et Barré donnée à la Comédie Italienne à Paris, avec un acteur comique très en vue, et qui fut jouée dans les colonies françaises. L’influence de ce type de spectacles du vieux continent sur les divertissements des colons au Nouveau monde est indéniable.
Carte noire nommée désir de Rébecca Chaillon a eu, ces dernières années, un immense succès. Ce spectacle, qui réunit huit performeuses au plateau et s’intéresse spécifiquement à la condition des femmes noires, a la particularité de séparer les femmes afrodescendantes du reste du public, en les plaçant sur un canapé de l’autre côté de la scène. N’est-il pas paradoxal de les séparer, dans la mesure où le but final du combat antiraciste est d’arriver à une égalité et une union de toutes et tous, peu importe la couleur ?
S. C. : Carte noire nommée désir est un spectacle performatif. Rébecca Chaillon invite le public à vivre une expérience qui commence par la discrimination que vivent les femmes noires, sauf que celle-ci est, pour une fois, prise à rebours. Elles sont invitées à suivre le spectacle depuis un espace privilégié qui leur est réservé, pour leur bien-être. C’est une démarche de sororité thérapeutique car les comédiennes qui rejoignent Rébecca Chaillon sur le plateau après le prologue, et qui viennent prêter main forte au tressage, sont assises dans cette même partie du public. Les spectatrices qui ont ainsi choisi de s’asseoir dans cette partie du théâtre participent à l’action, comme par procuration, dans un geste de prolongement. L’enjeu est d’amener le public, qui lui n’est pas discriminé, à se déplacer par rapport à ses attendus et à prendre conscience de ce qu’est la discrimination ordinaire que vivent les femmes noires de France. C’est un spectacle ludique et participatif démontant les préjugés avec humour, en convoquant la corporéité des comédiennes jusqu’à banaliser leur nudité et leur anatomie, afin que le public soit amené à voir d’abord des êtres humains, et que tout effet d’exhibition soit épuisé, vidé.

Carte noire nommée désir – Photo © Vincent Zobler
Le monde de la technique du spectacle vivant est peut-être encore moins divers que celui des artistes. Comment expliquez-vous ce manque de diversité ?
S. C. : Le manque d’ouverture du monde théâtral à l’altérité a eu pour conséquence de maintenir loin du théâtre tout une part de la société française, qui ne se sentait pas concernée par cette pratique artistique et sociale. Pour s’intéresser à tous les métiers techniques qui font le théâtre, il faut commencer par aller au théâtre et avoir le sentiment d’être représenté. À ma connaissance, il n’y a pas de chiffres susceptibles d’estimer la présence des créateur.rice.s racisé.e.s dans le domaine du costume, du son, de la lumière, de la scénographie, de la régie plateau, … ; mais aujourd’hui nous constatons, notamment au niveau des formations comme les licences professionnelles “Scénographie théâtrale” ou “Conception costume de scène et d’écran”, à l’Université Sorbonne Nouvelle, que nous avons de plus en plus de candidat.e.s non-blanc.he.s qui se présentent. La diversité d’origines des élèves est précieuse et stimulante car elle dynamise considérablement la créativité et l’ouverture des imaginaires.
Vous vous intéressez aux questions coloniales au théâtre depuis les années 80’-90’. Avec le mouvement Black Lives Matter et ses émules en France, la lutte antiraciste a pris, cette dernière décennie, un grand essor. Au théâtre, nous pensons notamment au collectif Décoloniser les arts, qui a publié un recueil manifeste en 2018. Parallèlement, l’extrême droite gagne du terrain et se rapproche dangereusement du pouvoir. Quel regard portez-vous sur l’évolution du débat public sur les questions coloniales, en particulier en ce qui concerne les scènes de spectacle vivant ?
S. C. : Je ne suis pas sûre que la lutte antiraciste soit plus forte aujourd’hui que dans les années 80’. La grande différence est surtout liée à Internet et aux réseaux sociaux. Les artistes racisé.e.s ne sont plus isolé.e.s, il.elle.s peuvent se concerter, s’associer, dialoguer et partager leurs expériences. Il.elle.s peuvent se constituer en collectif et peser sur l’opinion. Il.elle.s peuvent aussi accéder à la connaissance, à l’histoire des acteur.rice.s noir.e.s de France, aux auteur.rice.s d’Afrique et des diasporas et ne plus s’en laisser conter. Difficile de dire aujourd’hui aux comédien.ne.s qu’il n’y a pas de rôles noirs dans le répertoire français ou francophone pour justifier leur mise à l’écart.