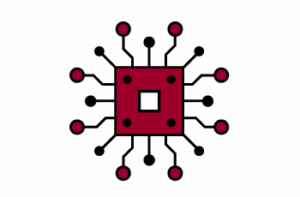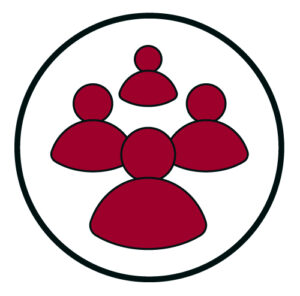La couleur, élément indissociable de la lumière, est au centre des questionnements et bouleversements occasionnés par la transition de l’éclairage à incandescence vers l’éclairage LED. Qu’il s’agisse de la perception que nous en avons, des moyens de l’évaluer, de l’identifier et de la nommer, ou encore de la mettre en œuvre et de l’utiliser, la couleur est le sujet principal de cette transition d’une technologie d’éclairage vers une autre. Au XVIIe siècle, Isaac Newton a mis en évidence la composition chromatique de la lumière en la décomposant en différents rayonnements lumineux colorés qui composent toute la gamme du spectre “visible” par l’œil humain. Ces rayonnements sont interprétés par notre système visuel comme une unique couleur blanche lorsqu’ils sont additionnés, ou comme un dégradé de couleurs lorsqu’ils sont dissociés par diffraction (phénomène de l’arc-en-ciel).
La perception des couleurs
Notre perception des couleurs dépend du spectre d’émission de la source de lumière qui nous permet de voir (soleil, flamme, lampe), des caractéristiques physiques des “objets” qu’elle éclaire et de celles de notre système visuel. Les différentes sources lumineuses utilisées dans le spectacle (halogène, iodures, fluo, LED, …) produisent chacune une lumière dont le spectre de rayonnements chromatiques est de composition différente ; leur lumière respective est